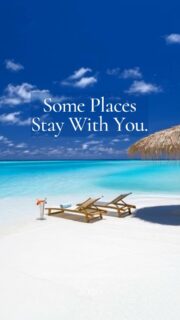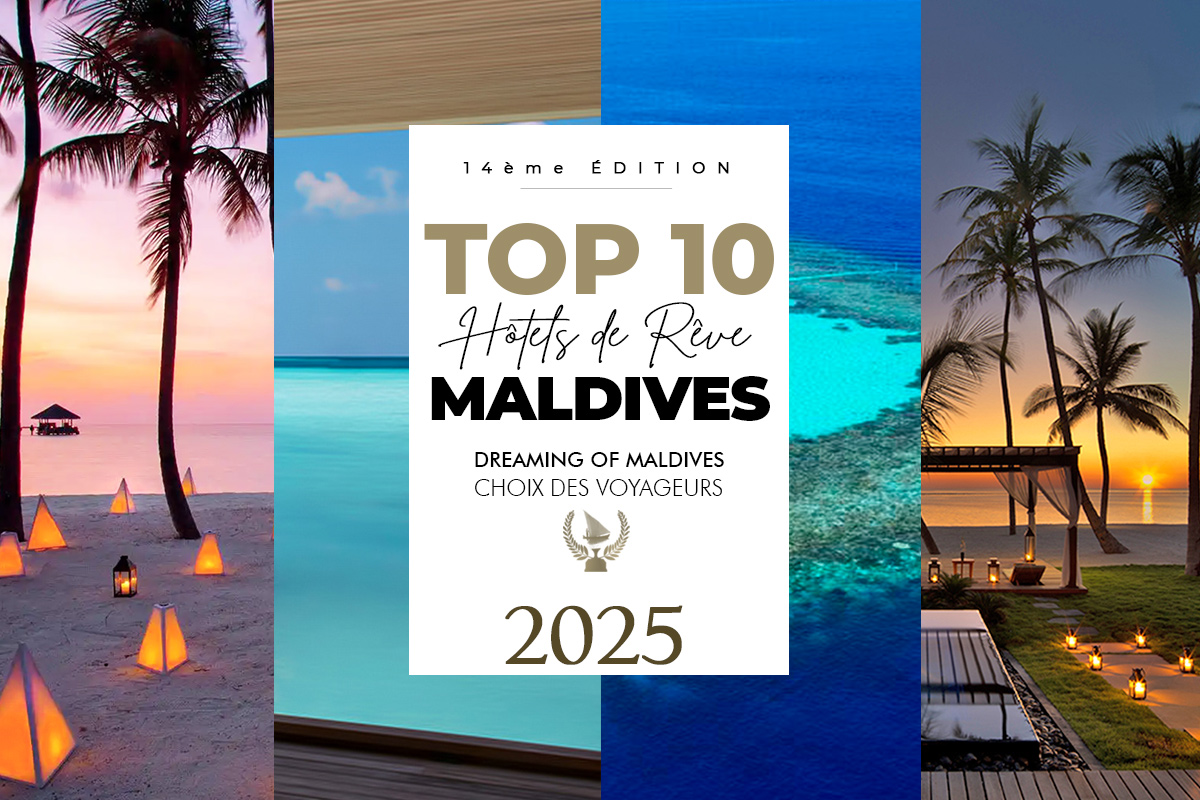Les requins aux Maldives. Cela devrait être une histoire de rêve, mais les faits récents ont changé les choses : aujourd’hui plus que jamais, ils évoquent la peur et le danger.
L’image du prédateur s’impose, reléguant au second plan celle du gardien des récifs et de la magie de son observation.
Chaque année, ils sont plus nombreux.
Les touristes, les images, les réseaux sociaux, les fameux « likes ».
Tout ceci serait bien futile si l’impact n’était pas aussi néfaste sur la nature. Les effets secondaires de cette addiction à la visibilité se font ressentir sur de nombreux plans, y compris les requins.
Alors, le problème est-il que les Maldives ont vraiment trop de requins ?
Ou est-ce une autre histoire… plus complexe, plus humaine ?
Il semble que oui.
Et c’est ici qu’elle commence.
Quinze ans après l’interdiction de la pêche aux requins, le gouvernement maldivien évoque pour la première fois la possibilité d’y mettre fin.
Dans le pays, le débat ressurgit.
Sur les atolls, les pêcheurs assurent qu’il y a désormais “trop de requins”, trop proches, trop nombreux, trop voraces, au point d’en faire les nouveaux concurrents de leur quotidien.
J’ai eu la chance de plonger à plusieurs reprises avec eux aux Maldives, du paisible requin-nourrice au de requin-marteau. J’y ai vu des animaux gracieux, essentiels à l’équilibre des récifs, bien loin des monstres redoutés dans l’imaginaire collectif.
Alors, face à la peur qui monte, j’ai voulu comprendre : que se passe-t-il vraiment ?
Derrière les titres alarmistes et les discours opposés, se cache une réalité bien plus nuancée : celle d’un archipel où pêcheurs, plongeurs, défenseurs de l’environnement et touristes en mal de sensations se croisent, souvent avec des visions très différentes d’un même océan.
Recrudescence des attaques de requins aux Maldives
Plusieurs incidents récents ont ravivé les tensions entre hommes et requins.
En avril 2024, un apnéiste de 30 ans a été blessé à l’épaule. Certains témoins ont évoqué un requin bouledogue, d’autres un accident d’hélice.
Quelques mois plus tôt, dans l’atoll de Laamu, un soldat avait perdu la vie lors d’un entraînement.
Il y a deux ans, une apnéiste a été attaquée par un requin-nourrice à “Shark Point”, un site célèbre où les requins sont nourris uniquement pour divertir les touristes.
Un groupe de snorkelers se jette alors à l’eau pour obtenir “la photo parfaite pour Instagram.”
Tout ça par vanité.
Tout ça pour le spectacle.
À lire : Attaque de requin aux Maldives. Vanité VS Monde Sauvage

Ces accidents, rares mais spectaculaires, ont suffi à réveiller les inquiétudes : la population de requins aurait-elle explosé depuis l’interdiction de leur pêche en 2010 ?
Sur les îles, la peur grandit. Des pêcheurs témoignent dans la presse de la présence de “grands requins tout près du rivage”. Et peu à peu, l’idée s’installe : les requins seraient devenus trop nombreux, voire agressifs.
Quand nourrir les requins tourne mal
Aux Maldives, le shark feeding est interdit. Pourtant, certains sites de plongée continuent d’y céder pour le plus grand bonheur des touristes.
Et parfois, la nature se charge de rappeler les règles.

Récemment, sur le spot très fréquenté de Shark Tank Dive Site, une plongée de ce type a mal tourné.
Un requin, attiré par un conteneur rempli d’appâts, s’est emmêlé dans la corde avant de s’en prendre aux plongeurs. ( une scène qui fait mal au cœur d’ailleurs…).
ވަލެއްގައި އޮޅިފައި އޮތް މިޔަރެއް ސަލާމަތްކުރަން އުޅުނު ބަޔަކަށް، އެ މިޔަރު ހަމަލާ ދޭ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ. މި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ ހިނގީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ ނެރު ކައިރީގައި އޮންނަ ޝާކް ޓޭންކް ޑައިވް ސައިޓުގައި.
— Mihaaru (@Mihaarunews) February 4, 2024
ތަފްސީލް: https://t.co/XH6xoAoRge pic.twitter.com/iorbpoTgHc
Un accident qui aurait pu être évité et qui montre combien il est absurde de vouloir transformer des prédateurs sauvages en figurants de vidéo pour réseaux sociaux.
Ce genre d’incident n’a rien d’isolé.
Partout où le shark feeding est pratiqué, en Polynésie, aux Bahamas, la Réunion, les comportements changent : les requins s’habituent à l’humain ( ils en ont peur normalement ), deviennent plus insistants, plus familiers, et parce qu’ils sont sauvages, ils deviennent parfois imprévisibles.
À Bora Bora, je l’ai personnellement vécu il y longtemps : on se met à l’eau, le capitaine jette les appâts et une horde de requins s’approchent frénétiquement de la pirogue ( et de nos jambes ) pour recevoir leur ration de poissons.
Fascinant. Mais à quel prix ?
Aparté : Allez jeter tous les jours des bouts de viande à des fauves au milieu de la savane et vous verrez leur comportement au bout de la troisième ou quatrième fois… Soudainement, le « spectacle » n’aura plus le même attrait. L’animal sera de moins en moins craintif.
On appellera cela un incident tragique et imprévisible de la Nature sauvage… surtout pas le résultat de notre brillante gestion touristique.
Et là, bien sûr, il n’y aura plus de discussion : il sera catalogué comme dangereux, voir éliminé.
Quand les réseaux nourrissent le mythe et attisent le danger
Je me souviens de l’époque où, dans certains resorts des Maldives, on nourrissait encore les requins et les raies en bord de plage. Un spectacle touristique, fascinant mais profondément perturbant pour la nature.
Heureusement, cette pratique a été interdite, enfin…officiellement. La rumeur court que certaines iles le pratiquent encore.
Le phénomène refait parfois surface.
Des excursions touristiques continuent parfois, discrètement, à attirer les requins-nourrices, ces géants dociles devenus icônes de photos et vidéos virales.
On voit aussi des plongeurs bouteilles nourrissant des requins ( et pas des nourrices cette fois ).
Le tout filmé. Un véritable piège à clics.
Mais derrière ces images idylliques, la réalité est plus sombre : plusieurs attaques ont déjà eu lieu.
Les requins s’adaptent, nous approchent un peu plus chaque fois.

Arrêtez de Rêver. Partez...
Nous recherchons les Plus Beaux Hôtels des Maldives aux Meilleurs Prix
En association avec notre Partenaire & Conseiller Voyage aux Maldives
Ces incidents ne sont pas dus à des “requins tueurs”, mais à un comportement humain irresponsable : s’approcher, les toucher, les nourrir… et briser cette crainte naturelle et mutuelle qui régit (régissait ? – cqfd ) notre coexistence.
Ce n’est pas le requin qui est vorace.
C’est nous.
Les requins vivent longtemps et leur mémoire n’est pas un mythe
Le requin est une espèce parfaite. Ils vivent longtemps et sont intelligents, instinctifs, sensibles. Chaque contact, chaque nourrissage, chaque appât jeté laisse une trace durable.
Une génération après l’autre, ils apprennent que l’humain rime avec nourriture. La proximité devient un réflexe, un comportement transmis.
Il y a encore quelques années, je croyais les Maldives préservées de ce genre d’interactions. Un sanctuaire où la vie marine évoluait librement, vierge de nos dérives.
Et c’était vrai.
Malheureusement, il semble que cet équilibre si merveilleux soit en train de changer. Les signes sont là, discrets mais inquiétants : requins qui s’approchent sans crainte, qui tournent plus près, qui attendent.
Pas parce qu’ils sont plus nombreux, mais parce qu’ils nous connaissent trop bien.
Et au fond, ce n’est pas une question de nature.
Le drame qui se joue entre l’homme et le requin n’est pas une fatalité biologique, mais le résultat amer de l’avidité humaine.
Ce que disent les chercheurs
Malgré la peur, les données scientifiques racontent une tout autre histoire.
Selon le Maldives Marine Research Institute (MMRI), aucune preuve n’indique une augmentation significative du nombre de requins.
Le programme national Sharkwatch, fondé sur plus de 11 700 relevés dans 540 sites, montre une stabilité depuis l’interdiction de la pêche.
Même si la population n’a pas augmenté, si on jette des restes de poissons toujours au même endroit, les requins se rassemblent. Visuellement, on croit qu’ils sont plus nombreux.
— Dr Shafiya Naeem, ancienne Directrice générale du MMRI
Les chercheurs insistent : les requins n’ont pas changé, c’est nous qui avons changé la façon dont nous interagissons avec eux.
Nos comportements, nourrissage, nouvelles techniques de pêche, gestion hasardeuse des déchets, modifient leur comportement naturel et les rapprochent des zones habitées.

Les requins n’ont pas soudainement envahi les Maldives, mais l’évolution des techniques de pêche, les pratiques de nourrissage et le tourisme viral ont peu à peu brouillé la frontière naturelle entre l’humain et le prédateur.
La colère des pêcheurs Maldiviens
Du côté des pêcheurs, le ressenti est tout autre.
Ils affirment perdre jusqu’à 40 % de leurs prises à cause des requins qui viennent mordre les lignes ou dévorer les poissons avant la remontée.
Dans une interview publiée par The Maldives Independent, un pêcheur de Laamu expliquait :
On voit de grands requins près du rivage. On met la ligne à l’eau, elle se fait couper, le poisson est parti.
– un pécheur Maldivien
Ces frustrations ont relancé l’idée de rouvrir partiellement la pêche aux requins, non pas pour le profit, mais pour “rétablir l’équilibre”.
Mais quel équilibre peut-on vraiment espérer rétablir si c’est notre propre comportement qui a rompu celui de l’océan ?
Les experts sont unanimes : la tension ne vient pas d’une explosion du nombre de requins, mais d’une modification de la relation homme-océan.
Tourisme mal encadré, déchets de poisson jetés près des plages, nourrissage illégal… ces pratiques enseignent littéralement aux requins à venir vers nous.
« Nous ne sommes pas contre le tourisme lié aux requins« , explique Shaha Hashim, directrice de Maldives Resilient Reefs.
« Mais il faut le réguler, et vite.«
Je partage cet avis. Après avoir plongé avec eux, je sais à quel point leur comportement dépend du nôtre.
La question n’est pas : y a-t-il trop de requins aux Maldives ?
Mais plutôt : que faisons-nous pour en arriver là ?
Il y énormément de requins aux Maldives et c’est tant mieux.
Ce n’est pas leur nombre qui menace l’équilibre, mais nous.
Lire l’article avec interviews en anglais sur The Maldives Independent.
Suivez-nous sur Facebook, YouTube et Instagram pour plus de Rêves des Maldives.